Quelles perspectives dans l’hépatite D ?
Pendant longtemps, l’interféron-α pégylé a été la seule option thérapeutique dans l’hépatite D chronique, jusqu’à l’introduction du bulévirtide en 2020. Mais les résultats thérapeutiques se sont-ils vraiment améliorés depuis ? Et quels sont les candidats médicaments dans les starting-blocks ?
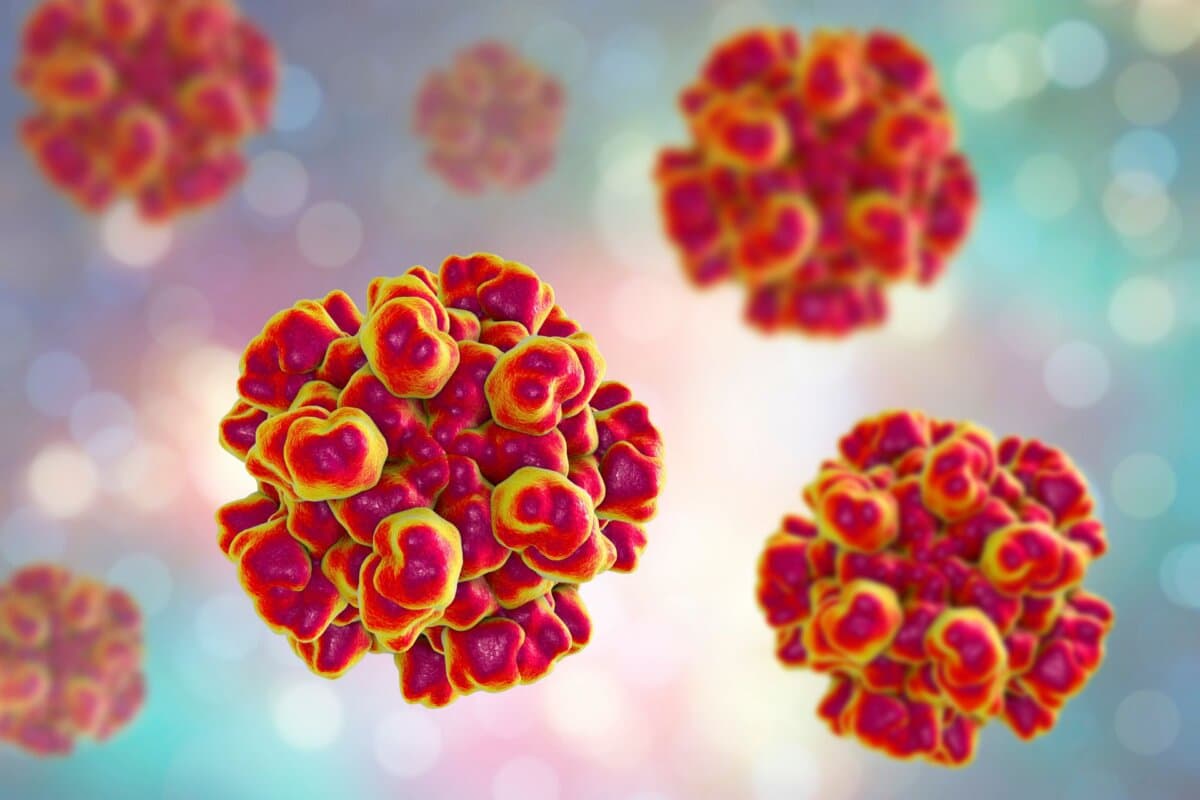
L’hépatite D chronique est la forme la plus sévère des hépatites virales. Les personnes atteintes sont à un risque particulièrement élevé de développer une cirrhose et des complications telles qu’un carcinome hépatocellulaire ou une décompensation hépatique.
Pendant des décennies, les patients atteints d’hépatite D chronique ont généralement été traités par l’interféron-alpha pégylé (PEG-IFN-α). Outre les taux de réponse virologique limités, la mauvaise tolérance de ce traitement est toutefois un facteur limitant. Pietro Lampertico, Université de Milan, fait le point sur les derniers développements dans le paysage thérapeutique de l’hépatite D chronique.
Bulévirtide
Depuis près de cinq ans, le bulévirtide est autorisé en Europe (ainsi qu’en Suisse [N.D.L.R.]), à la dose de 2 mg/j pour le traitement des patients adultes atteints d’hépatite D chronique et ayant une maladie hépatique compensée. Premier représentant de ce que l’on appelle les inhibiteurs d’entrée, il empêche les virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite D (VHD) de pénétrer dans les hépatocytes. Cet effet est fondé sur la liaison de la substance active au cotransporteur sodium-taurocholate (NTCP).
Le bulévirtide s’est avéré être une monothérapie sûre et efficace pendant une durée allant jusqu’à 144 semaines, tant dans les études cliniques que dans la pratique. Ces études ont notamment montré qu’un traitement à long terme par le bulévirtide pouvait réduire le risque de décompensation chez les patients cirrhotiques. Des résultats prometteurs en termes d’efficacité et de sécurité ont également été observés chez des sujets ayant une hépatite D chronique et co-infectées par le VIH.
Le traitement par le bulévirtide a toutefois ses limites. Non seulement il est coûteux, mais il ne permet d’obtenir que de faibles taux de patients traités avec une absence de détection de l’ARN du VHD. De plus, aucune diminution significative de l’antigène de surface de l’hépatite B (HBsAg) n’a pu être démontrée. Or, cela est important pour le succès du traitement. Enfin, un traitement à long terme est nécessaire dans la plupart des cas. Le risque de rechute est en effet élevé en cas d’arrêt.
Thérapie combinée
L’association de 2 mg de bulévirtide au PEG-IFN-α constitue une alternative à la monothérapie. Selon les résultats d’études, le traitement combiné permet d’améliorer les taux de non-détection de l’ARN du VHD. En outre, au moins une partie des participants ont obtenu une perte significative de l’AgHBs. Toutefois, la suppression virologique 24 semaines après la fin du traitement était comparable chez les patients sous PEG-IFN-α plus bulévirtide 2 mg et chez ceux traités uniquement par PEG-IFN-α, écrivent les auteurs. Ils résument que les résultats étaient plus favorables avec la combinaison de PEG-IFN-α et de bulévirtide 10 mg/j. Mais cette dose n’est pas disponible à ce jour.
Lonafarnib
Le lonafarnib est une autre substance actuellement à l’étude dans le cadre d’essais cliniques sur le traitement de l’hépatite C chronique. Il s’agit d’un inhibiteur de la farnésyltransférase qui est administré par voie orale. Il est généralement associé au ritonavir dans le but de prévenir les effets secondaires d’ordre gastro-
intestinal.
Dans les études de phase II, des taux de réponse virologique prometteurs ont été observés avec un traitement par lonafarnib et ritonavir avec ou sans PEG-IFN-α. Ces résultats devront toutefois être confirmés dans des études de phase III.
Autres candidats médicaments expérimentaux
REP 2139 est un polymère d’acide nucléique qui bloque l’assemblage des particules subvirales du VHB. Il favorise ainsi la dégradation de l’AgHBs intracellulaire et inhibe la réplication du VHD. D’autres données devront en confirmer l’efficacité et l’innocuité dans l’hépatite D chronique. Celles issues de grandes études de phase II seront particulièrement importantes.
Une autre approche intéressante qui intervient dans l’expression du gène du VHB est le traitement de l’hépatite D chronique au moyen de petits ARN interférents (siRNA) ou d’anticorps monoclonaux (moAB). La combinaison de siRNA et de moAB s’est notamment montrée efficace. Des études ont ainsi montré une réduction de l’ARN du VHD et du taux d’AgHBs dans les 12 à 24 semaines suivant le début du traitement. Les experts estiment que la suppression virologique précoce sous cette thérapie combinée semble plus profonde que sous monothérapie par le bulévirtide. Un essai contrôlé randomisé à ce sujet n’est toutefois pas encore disponible.
- Lampertico P et al. Antiviral therapy for chronic hepatitis delta: new insights from clinical trials and real-life studies. Gut 2024; doi: 10.1136/gutjnl-2024-332597